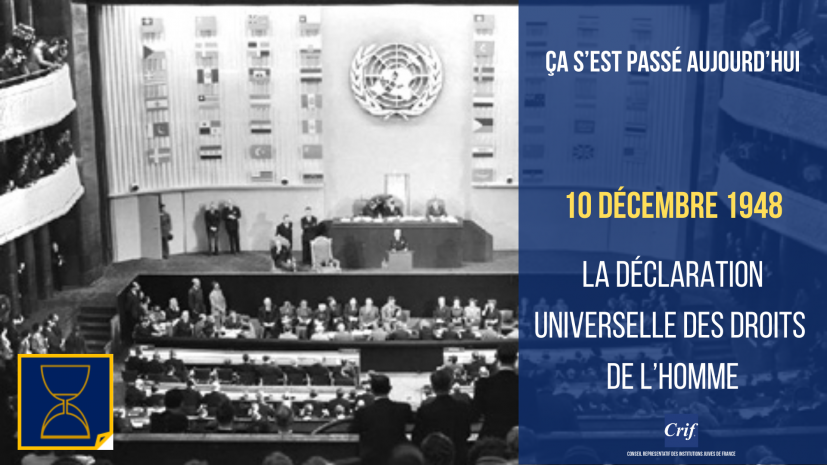Le 10 décembre 1948, au palais de Chaillot à Paris, les 58 membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) se réunissent pour la dernière fois en France avant de transférer leur siège à New York. Lors de cette séance historique, ils adoptent la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), un texte fondateur visant à établir les droits et libertés fondamentaux de chaque individu, indépendamment de sa nationalité, de sa race, de sa religion ou de son genre. Cette adoption survient dans un contexte mondial marqué par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, soulignant la nécessité d’un socle commun pour la dignité humaine.
Les causes : panser les plaies de l’humanité
Les ravages de la Seconde Guerre mondiale ont révélé l’ampleur des violations des droits humains, avec des génocides, des crimes de guerre et des actes de barbarie inimaginables. Face à ces atrocités, la communauté internationale a ressenti l’urgence de prévenir de telles horreurs à l’avenir. La création de l’ONU en 1945 visait à instaurer un cadre de coopération internationale pour maintenir la paix et promouvoir les droits humains. La Déclaration universelle des droits de l’homme émerge alors comme une réponse directe à ces événements, visant à affirmer les droits inaliénables de chaque être humain et à établir des normes universelles de justice et d’égalité.
Les étapes de l’adoption
1.1946 : La Commission des droits de l’homme
Sous la présidence d’Eleanor Roosevelt, veuve du président américain Franklin D. Roosevelt et figure emblématique des droits humains, la Commission des droits de l’homme est créée par l’ONU le 10 février 1946. Sa mission est de rédiger un document définissant les droits fondamentaux de tous les êtres humains, sans distinction.
2. 1947 : Une rédaction internationale
La rédaction de la DUDH est confiée au juriste français René Cassin, membre de l’Assemblée constituante française. Cassin, avec l’aide d’autres contributeurs internationaux tels que Charles Malik du Liban et Peng Chun Chang de Chine, élabore un texte intégrant diverses traditions juridiques et culturelles en décembre 1947. Les débats sont intenses, reflétant les tensions de l’époque, notamment entre les idéologies occidentales et soviétiques. Malgré ces divergences, un consensus est progressivement atteint sur les principes fondamentaux des droits humains.
3. 1948 : Adoption au palais de Chaillot
Après deux années de discussions et de révisions, la Déclaration universelle des droits de l’homme est soumise au vote final. Le 10 décembre 1948, elle est adoptée par 48 des 58 États membres présents, avec 8 abstentions. Cette adoption marque la reconnaissance mondiale des droits humains comme étant universels et inaliénables, posant les bases de la législation internationale et nationale future en matière de droits de l’homme.
Les pays signataires et les défis actuels
Lors de son adoption en 1948, 48 pays ont voté en faveur de la DUDH. Parmi eux figuraient des nations de toutes les régions du monde :
– Europe : France, Royaume-Uni, Belgique, Norvège, Suède, etc.
– Amériques: États-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Argentine.
– Asie : Chine (République de Chine), Inde, Philippines, Liban.
– Afrique : Égypte, Éthiopie.
Les abstentions initiales concernaient 8 pays, dont les nations du bloc soviétique (URSS, Pologne, Ukraine, Biélorussie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie), l’Afrique du Sud (sous le régime de l’apartheid), et l’Arabie saoudite, opposée à certains articles sur l’égalité hommes-femmes et la liberté religieuse.
Aujourd’hui, la DUDH est reconnue par les 193 États membres des Nations Unies comme un document fondamental. Si elle n’est pas juridiquement contraignante, elle sert de référence universelle. Elle a inspiré des instruments tels que la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ou encore la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.
Cependant, son application reste inégale. Des régimes autoritaires comme ceux de la Corée du Nord, de l’Iran ou du Myanmar continuent de bafouer certains droits fondamentaux. Les discriminations, les conflits armés, et les violations des droits humains rappellent que la DUDH demeure un idéal à atteindre.
Un texte visionnaire mais encore inachevé
La DUDH, composée de 30 articles, établit des droits essentiels tels que le droit à la vie, à la liberté, à l’éducation et à la liberté d’expression. Elle pose également des principes d’égalité, de non-discrimination et de protection contre la torture et les traitements inhumains. Depuis son adoption, la Déclaration a inspiré de nombreuses constitutions nationales et traités internationaux, devenant une référence majeure dans le domaine des droits humains.
Cependant, malgré son universalité proclamée, la mise en œuvre de la DUDH reste incomplète. Les inégalités persistent, et de nombreuses régions du monde continuent de subir des violations des droits humains. Les défis contemporains tels que les discriminations, les conflits armés et la pauvreté montrent que l’idéalisme de la Déclaration doit être constamment renforcé par des actions concrètes.
La Déclaration universelle des droits de l’homme demeure un symbole puissant d’unité et d’espoir pour l’humanité. Adoptée dans un contexte de reconstruction mondiale, elle incarne une aspiration commune à la dignité, à la justice et à l’égalité. Cependant, son application reste un défi, exigeant une vigilance constante face aux violations des droits fondamentaux. Plus de 75 ans après son adoption, elle nous rappelle que la paix et la justice ne sont possibles qu’en mettant l’humain au cœur des priorités, au-delà des frontières et des idéologies. La DUDH continue d’inspirer les mouvements pour les droits humains et reste une pierre angulaire dans la quête mondiale pour un monde plus juste et équitable.
Ezekiel Padonou